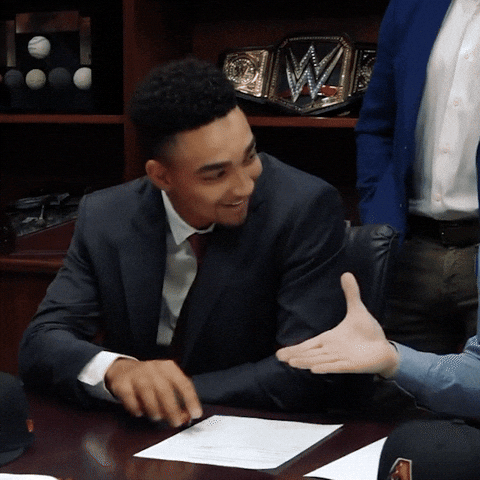H16
-12/11/2025- Si l’actualité française a surtout été marquée récemment par les délires budgétaires des différents partis tous résolument pro-dépense, le reste du monde, indifférent aux gesticulations françaises, continue d’avancer. C’est ainsi qu’au milieu de ce qui ressemble à une guerre commerciale, Donald Trump a rencontré son homologue chinois Xi Jinping.
Et alors que beaucoup pariaient, à tort, sur un accroissement des tensions sino-américaines, force est de constater … le contraire.
Les semaines et les mois précédent avaient été le théâtre de hausses de tarifs douaniers de la part des États-Unis, ainsi qu’une restriction à l’exportation des terres rares de la part de la Chine (qui en possède un quasi-monopole). Compte-tenu du poids des deux économies et de leur interconnexion, la situation était, de prime abord, particulièrement problématique.
Cependant, il ressort de la réunion entre les deux présidents que la Chine va faire en sorte que les États-Unis puissent acheter plus facilement des terres rares et que, de leur côté, les États-Unis vont suspendre les restrictions visant des entreprises chinoises placées sous surveillance. Mieux encore, les frais douanier américains vont être réduits, passant de 20% à 10%. En compensation, la Chine s’engage à acheter plus de produits fermiers venant des États-Unis, dans un troc digne d’un jeu vidéo « +10 minerais, -20 haricots ».
Un autre point de tension a été abordé lors de cette rencontre, portant sur l’épineuse question taïwanaise. Le président chinois a cependant confirmé au président américain que rien ne serait tenté vis-à-vis de l’île de Formose tant que Trump serait président.
Eh oui : ceux qui continuent de prendre Trump pour un éléphant (républicain ?) dans un magasin de porcelaine (chinoise ?) en seront pour leurs frais puisqu’une fois encore, les gesticulations préliminaires – qui laissaient imaginer le pire – n’ont servi que de base de négociation à des arrangements beaucoup plus diplomatiques et posés.
Ces négociations s’inscrivent en réalité dans la politique classique que mène Trump depuis son premier mandat, à savoir une diplomatie personnelle et mercantiliste. S’il est bien sûr trop tôt pour voir les résultats de cette réunion avec la Chine, on peut néanmoins constater que les choses vont dans le bon sens et qu’on a assiste à un rapprochement entre les deux pays.
L’actualité mentionne souvent le G7 (en tant que groupe des sept plus grandes puissances influentes occidentales), tout comme on évoque parfois le G20 qui réunit les vingt nations les plus puissantes. Le format G2, nettement moins connu, regroupe les États-Unis et la Chine et illustre bien la nouvelle configuration mondiale, dans laquelle c’est surtout ce couple, plus que le G7 ou le G20 qui désormais compte pour la destinée du monde.
C’est assez logique : ces deux énormes économies, même si elles cherchent à gagner leur indépendance, sont très interconnectées. La Chine est ainsi actuellement le quatrième partenaire commercial des États-Unis en matière d’exportation de biens et la troisième source des importations américaines, expliquant d’ailleurs le déficit commercial en faveur de la Chine. Inversement, en matière de service, on assiste à un surplus commercial de la part des États-Unis.
Cette place prépondérante du couple sino-américain ne vient pas de nulle part. L’actuelle course technologique est le principal moteur de la croissance, à tel point d’ailleurs que ces deux pays ont creusé un écart marqué avec le reste du monde. Rien qu’en matière d’intelligence artificielle par exemple, ces deux pays ont chacun investi des centaines de milliards de dollars dans cette technologie : plus de 400 milliards pour les Américains et plus de 100 milliards pour les Chinois entre 2013 et 2024. En comparaison, le Royaume-Uni, le troisième pays à avoir le plus investi dans ce secteur, n’a été capable d’investir que 26 milliards.
Du reste, tant en matière d’intelligence artificielle que pour d’autres technologies, on comprend que ces deux pays ont besoin l’un de l’autre : d’un côté, les États-Unis ont besoin des terres rares chinoises qui sont nécessaires à produire les composants informatiques qu’on retrouve partout dans l’industrie. De l’autre côté, la Chine nécessite certains produits et services américains.
Bien sûr, cette interdépendance peut se réduire dans le futur, en profitant pour les deux concurrents de l’avantage d’être des « pays-continents » : les États-Unis disposent par exemple d’importantes réserves de terres rares qui pourraient être exploitées, pendant que la montée en gamme des produits chinois pourrait offrir une plus grande indépendance technologique à l’Empire du Milieu.
Autre atout, ces deux pays disposent d’universités et de formation de classe mondiale : pendant que les Américaines continuent de truster les premières places, on assiste à une explosion des universités chinoise dans les classement internationaux comme celui de Shanghai, tout particulièrement dans le domaine de l’ingénierie.
Ces différents éléments s’accumulent et laissent penser qu’il est très improbable qu’une véritable guerre, frontale et destructrice, survienne entre ces deux pays, au-delà même de l’aspect plus stratégique que ce sont deux puissances nucléaires. En somme, en lieu et place de la Guerre froide qu’on avait connu entre les Américains et les Soviétiques, les nouvelles relations internationales tiennent plus d’une colocation sino-américaine où les deux puissances se chicanent un peu pour la télécommande du monde mais se mettent d’accord sur celui qui va sortir les poubelles et c’est souvent l’Europe.
D’ailleurs, dans ce partage, c’est la question qui revient : quelle pourra être la place de l’Europe et de la France ?
Le commerce européen et français sont étroitement liés à celui de la Chine et des États-Unis. Pourtant, l’Europe et la France disposent d’un potentiel mal exploité : leur vivier de main-d’œuvre très qualifiée et d’ingénieurs de bonne qualité. Avec un environnement plus favorable aux affaires et à l’entrepreneuriat, elles pourraient déployer des technologies innovantes.
Ce n’est pas un rêve inaccessible : rappelons par exemple que les prix Nobel de physique sont très souvent des EChuropéens et notamment des Français… Qui exercent souvent dans les pays anglosaxons. Plusieurs pointures de l’intelligence artificielle comme Yoshua Bengio ou Yann LeCun sont français mais exercent hors Europe (en l’espèce au Canada et aux États-Unis).
Une déréglementation, une simplification bureaucratique et une baisse des taxes et ponctions qui s’abattent sur les industries et les nouvelles technologies européennes donneraient une solide carte à jouer de la France et de l’Europe face à la Chine et aux États-Unis.
Car après tout, après s’être volontairement interdit d’exploiter leurs ressources minières (par écologisme total) ou financières (par socialisme terminal), que reste-t-il d’autre aux Européens que leurs cerveaux ?