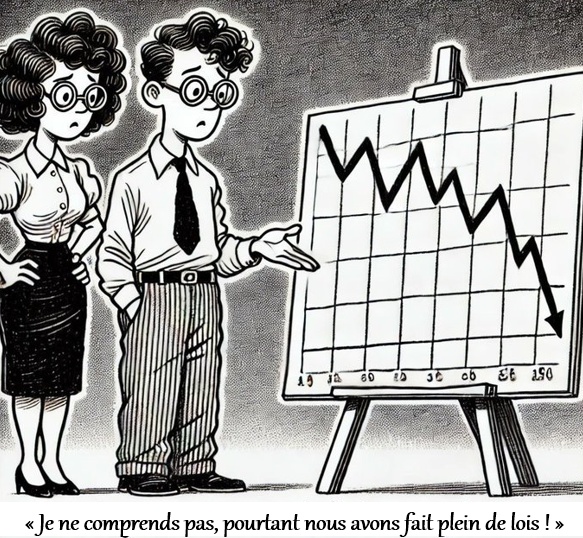- 5/2/2025 - « L'État centralisé, avec son autorité abstraite, accorde peu d’importance aux particularités locales. Il cherche l’uniformité dans la loi, le commerce et la culture, érodant ainsi les traditions qui donnent un sens à l’existence humaine. La véritable liberté ne peut perdurer dans un tel système, car elle repose sur l’autonomie des communautés, et non sur les diktats de bureaucrates éloignés. »
Cette phrase appartient à l’écrivain américain Allen Tate, qui l’a prononcée dans un article du recueil emblématique I'll Take My Stand (1930), manifeste de douze intellectuels du Sud des États-Unis critiquant l’expansion du contrôle de l’État moderne, les excès de l’industrialisation et du consumérisme, ainsi que l’uniformisation des modes de vie. Ils y plaidaient pour la décentralisation, la liberté individuelle, la préservation des traditions culturelles locales et du mode de vie rural. Ce manifeste constitue l’une des expressions les plus marquantes de la pensée des Southern Agrarians (Agrariens du Sud), qui défendaient l’héritage confédéré et les principes fondateurs de la Confédération américaine.
Parmi les soutiens actuels du Parti républicain et du tandem Trump-Vance, nombreux sont ceux qui voient en eux des défenseurs de traditions profondément ancrées dans l’histoire des États-Unis : la liberté face au pouvoir centralisé, le droit au port d’armes, l’attachement à l’éthique protestante et la préservation de l’identité locale. Pour les mouvements antifédéralistes et conservateurs, l’État bureaucratique et « thérapeutique » est perçu comme une tumeur cancéreuse, et ceux qui le renforcent sont qualifiés de « communistes ». Comme les auteurs de I'll Take My Stand, ils expriment la méfiance vis-à-vis des intellectuels progressistes, des institutions fédérales et des élites industrielles.
Trump et, plus encore, J.D. Vance ont cherché à séduire cet électorat. Dans son livre Hillbilly Elegy (adapté en série), Vance cite d’ailleurs I'll Take My Stand comme une source d’inspiration. Il insiste sur la nécessité de promouvoir l’autonomie et la mobilité sociale tout en réhabilitant les valeurs traditionnelles. Il déplore la disparition de repères essentiels tels que le travail, l’honneur et la discipline au sein de la classe ouvrière américaine, met en avant l’importance de la culture et de l’identité collective, et appelle à concilier traditions et exigences du monde globalisé et technologique.
C’est là que réside toute l’ambiguïté de la posture républicaine.
« Aujourd’hui, la plus grande menace pour la démocratie américaine, c’est la Big Tech », déclarait Vance en 2022 sur Fox News, dénonçant le pouvoir excessif des géants du numérique. Pourtant, cela ne l’empêche pas de collaborer avec des figures influentes du secteur. Il ne rejette pas la technologie en soi, mais estime qu’elle doit servir à construire une société plus conservatrice. Il soutient des initiatives visant à renforcer l’autonomie des individus et des communautés locales et considère – ou feint de considérer – la technologie comme un outil qu’on peut utiliser pour le rétablissement des valeurs qui lui sont chères.
Or, la technologie et la grande entreprise obéissent à leur propre logique de développement, bien éloignée des idéaux de l’Amérique profonde. Et la métamorphose de l'État-Léviathan en un monstre différent ne se fait pas au profit de l'autonomie locale ni de la restauration des valeurs traditionnelles.
La révolution conservatrice ?
Beaucoup ont vu en Trump un rempart contre les dérives wokistes, au point d’être subjugués par une gratitude démesurée pour avoir bousculé les dogmes déconstructionnistes et réaffirmé des évidences de bon sens. Ses simples mots sur l’existence de deux genres (et non 56) ont provoqué un immense soulagement, comme si le brouillard toxique du politiquement correct et de la censure s’était dissipé pour de bon.
Mais si le libéralisme globaliste a perdu une bataille, il n’a pas perdu la guerre. Trump a été élu avec une large majorité, mais près de la moitié des Américains restent dans le camp adverse. L’Europe, où cette idéologie est profondément ancrée dans les fondements de l’Union européenne, est particulièrement désemparée. Ce séisme politique ne fera qu’exacerber les tensions.
Néanmoins, les élites économiques qui font aujourd’hui allégeance à Trump en dénonçant le wokisme, l’inclusivité, le fact-checking et la discrimination positive n’hésiteront pas à retourner leur veste dès le retour des démocrates. Ce ne sont peut-être que les Cent-Jours de nos Gérard de Villefort du grand business.
Mais l’essentiel est ailleurs : malgré sa rhétorique sur les valeurs traditionnelles, Trump n’est pas un conservateur et n’a pas d’agenda véritablement conservateur. Son discours sert de paravent à un projet bien plus ambitieux : la transition vers la Corpocratie.
Quelques jours après leur prise de fonction, le duo Musk-Trump a incité massivement les fonctionnaires fédéraux à démissionner. Il s’agit là d’une marche ultralibertaire visant à accélérer la démolition de l’État classique pour instaurer un « État-Entreprise ». Cette dynamique est portée par les grandes multinationales et le capitalisme des plateformes, en particulier les géants du numérique.
Pour Elon Musk et d’autres figures du capitalisme numérique, les politiques identitaires ne sont qu’un gaspillage de ressources. Ils ne cherchent pas à restaurer un ordre ancien, mais à instaurer un ordre nouveau, fondé sur l’efficacité économique. À leurs yeux, l’agenda progressiste est une impasse. Pour que l’Amérique redevienne une puissance dominante, il faut en finir avec ces entraves inutiles. Ce n’est pas une question de valeurs traditionnelles, mais de gestion rationnelle du capital.
Ce modèle repose sur un libertarianisme radical et la doctrine de « l’État minimal » : réduction de la « charge de l’État », baisse des impôts (en particulier pour les multinationales), diminution des dépenses sociales, et un État réduit à une fonction de « veilleur de nuit » (minarchisme). Il s’accompagne d’une vision d’un « État dans un smartphone », où les services publics seraient entièrement privatisés et digitalisés.
À long terme, des institutions essentielles comme la santé publique ou la défense civile pourraient être totalement supprimées, tandis que l’éducation, la médecine, la justice, la recherche et les douanes se verraient gérées de manière privée. Dans ses formes les plus extrêmes, même le service de police pourrait devenir privé.
Dans cette optique, ce à quoi nous assistons, ce n’est donc pas une révolution conservatrice, mais comme exprimé par certains observateurs, une « seconde révolution bourgeoise » ou une « révolution contre le politique ». La première révolution a eu lieu au XVIII siècle contre les privilèges féodaux et les entraves venant du pouvoir monarchique. La seconde révolution se fait contre la démocratie en tant que telle (R. Belkovitch).
L’État-Entreprise
Dans Le Temps de l’État-Entreprise (2016), Pierre Musso définissait le Politique comme la fiction articulant la souveraineté sur la communauté et assurant la liaison entre la société civile et les institutions pour maintenir la cohésion sociale. Il voyait en Trump, Macron et Berlusconi les figures pionnières de l’État-Entreprise, catalysant la transition vers une corpocratie et l’avènement du pouvoir des grandes corporations transnationales. Les qualifiant d'« anti-politiques en politique », il démontrait que l’État et l’entreprise ne sont plus séparés, mais fusionnent en une entité hybride, mêlant régulation publique et logique capitaliste.
Quelle est l’idéologie ou le credo de Trump ? Selon Musso, c'est avant tout le credo managérial de l’efficacité, qui est fondamentalement anti-politique. L’État n’est plus un simple régulateur ou garant du bien commun ; il devient un acteur économique direct, adoptant les pratiques managériales des grandes entreprises. La technicité, dans ce cadre, est présentée comme une réalité neutre et objective, aveugle à toute dimension civilisationnelle. Sa seule vérité réside dans l’action efficace. L’utilité économique du politique se substitue à sa légitimité. Le gouvernement doit désormais être dirigé et géré comme une entreprise.
Elon Musk s’impose aujourd’hui comme un acteur politique mondial, intervenant sur tous les sujets et suscitant à la fois stupéfaction et indignation. Cette situation découle naturellement de l’emprise croissante des entreprises sur l’État, progressivement corrompu et soumis à leur logique.
L’économiste John K. Galbraith, en parlant, il y a une vingtaine d’années, de l’alliance entre l'État et les grandes entreprises, soulignait cette mutation : l’État-prédateur est une post-démocratie régie par les intérêts des lobbies et de la classe prédatrice composée de cadres supérieurs d’entreprises. Cette nouvelle oligarchie a décidé de s’emparer de l’État pour le gérer en fonction de ses besoins propres. Loin de limiter l’emprise du gouvernement sur l’économie, l’État-prédateur vise à l’approfondir, détournant ainsi l’action publique et les fonds publics au profit d’intérêts privés. Si le discours officiel reste libéral, c’est précisément pour masquer cette forme perverse d’étatisme mise au service des grands groupes.
Comment s’opère cette conquête ?
En exploitant les sentiments antigouvernementaux profondément enracinés, les élites actuelles et leurs alliés de la Big Tech accélèrent l’avènement de la Corpocratie, un État-Entreprise remplaçant l’État-Léviathan. La rhétorique « antisystème » séduit les laissés-pour-compte de la mondialisation, mais elle ne fait que substituer une bureaucratie à une autre – celle des « managers efficaces » et des dirigeants de grandes entreprises.
Portée par un discours populiste, la campagne électorale rallie un large électorat, tandis que la nouvelle classe dirigeante justifie son ascension par la nécessité de combattre le « Léviathan étatique ». Jugée inefficace, l’ancienne bureaucratie est démantelée et remplacée par des « managers performants » issus du secteur privé, dont les rémunérations explosent sous prétexte d’efficacité et de transparence.
À mesure que les grandes entreprises prennent le pas sur l’État, les inégalités se creusent : une minorité privilégiée accapare l’essentiel des richesses, tandis que la majorité voit ses intérêts relégués au second plan.
Il y a quelques années, le géographe américain Joel Kotkin mettait en garde contre une nouvelle tyrannie oligarchique dominée par les milliardaires de la tech. Selon lui – et d’autres, comme Yanis Varoufakis, auteur des Nouveaux serfs de l’économie (2024) – le capitalisme classique a cédé la place à un « techno-féodalisme » où une poignée de nouveaux seigneurs exerce un pouvoir démesuré. Aux États-Unis, cinq entreprises détiennent la majeure partie du capital, tandis qu’une poignée de magnats de la tech, âgés en moyenne d’une quarantaine d’années, possèdent des fortunes de plusieurs dizaines de milliards de dollars. « Nous devrons vivre sous leur influence toute notre vie », avertissait Kotkin.
Ce bouleversement s’explique par la mondialisation et la financiarisation de l’économie. La délocalisation industrielle vers la Chine a coûté 1,5 million d’emplois au Royaume-Uni et 3,4 millions aux États-Unis, affaiblissant les classes moyennes, autrefois pilier du capitalisme libéral.
Dans The Coming of Neo-Feudalism (2016), Kotkin déplorait également l’alliance de ces féodaux tout-puissants avec le « clergé intellectuel » wokiste. Il plaçait quelques espoirs dans une nouvelle génération de jeunes conservateurs – tels que Josh Hawley, J.D. Vance ou Marco Rubio – qu’il considérait capables de défendre les classes populaires tout en s’opposant à la révolution culturelle de la gauche. Dans un article récent du Figaro, il se réjouissait de la scission de l’oligarchie en deux camps, estimant qu’elle forcerait les élites à nouer des alliances au-delà de leur propre cercle et à prendre en compte les intérêts de la classe moyenne, au cœur des slogans électoraux.
Ses espoirs sont-ils fondés ?
Les nombreuses promesses faites aux ouvriers, aux cols bleus et aux hillbillies déclassés par la mondialisation seront-elles tenues ? C’est précisément sur leur soutien que Trump et Vance ont bâti leur stratégie électorale.
American dream
On ne peut nier que Trump nourrit une certaine nostalgie pour l’âge d’or de l’Amérique, ni ignorer qu’il incarne et ravive certains de ses mythes fondateurs. C’est le mythe du self-made man, celui de la frontier toujours repoussée, d’une modernité sûre d’elle et conquérante, d’un progrès technique sans limites et d’un messianisme fier. Trump rêve des années 1960-1970, d’un « âge doré américain » qu’il voudrait restaurer.
Mais dans leur version 2.0, ces mythes sont profondément déformés. L’Amérique n’est plus la même, le monde non plus. La mobilité sociale est faible, la classe moyenne menacée. Trump n’est pas un self-made man, quoi qu’il en dise. Aujourd’hui, repousser la frontier, est-ce envahir le Canada ou le Groenland ? Est-ce conquérir l’espace à coups de projets privés portés par les ambitions personnelles de milliardaires ?
Il y a une cinquantaine d’années, le monde occidental a connu un bouleversement majeur, bien que passé inaperçu. Et comme le dit le dicton, il est impossible de reconstituer la viande une fois hachée.
« L’idée du progrès est la plus morte des idées mortes », écrivait déjà Lewis Mumford en 1932, et le siècle qui a suivi lui a donné raison. Désormais, le progrès rime davantage avec précipitation vers la catastrophe, avec un hédonisme égoïste et irresponsable. Quand on parle de progrès, on pense à Don’t Look Up.
Derrière les discours nostalgiques de Trump et Vance, qui résonnent chez une partie de l’électorat, se profile une Amérique bien différente. Dans cette nouvelle réalité, les hillbillies risquent de rester aussi marginalisés que dans l’ouvrage éponyme de J.D. Vance.
Tout laisse croire que les oligarques du XXIᵉ siècle, fascinés par la technologie et le transhumanisme, se montreront indifférents aux questions de démographie, de mobilité sociale et de pauvreté. Bien plus éloignés du peuple que les industriels d’autrefois, ils se distinguent par une ignorance historique et culturelle frappante, qui, selon Kotkin, les rend plus dangereux que l’ancienne aristocratie.
L’influence des oligarchies modernes est accrue grâce à la technologie, qui leur confère un contrôle toujours plus grand sur nos pensées, nos lectures et nos écoutes. Henry Ford et Andrew Carnegie n’étaient pas des gentils, mais ils ne dictaient pas notre façon de penser. Une tyrannie appuyée sur la technologie ne peut être défaite, disait Aldous Huxley.
L’ignorance – si ce n’est l’indifférence – envers les enjeux historiques et culturels va de pair avec un autre trait propre aux dirigeants qui administrent leur État comme une entreprise : le décisionnisme. Ce mode de gouvernance autoritaire repose sur des décisions tranchées, prises sans égard pour les conséquences à long terme. Intelligence artificielle, cryptomonnaies, fiscalité, licenciements massifs de « bureaucrates inutiles »… Autant de mesures dans l’air du temps, rentables à court terme. Et après ? Qui s’en soucie ?
La politique est saisie par l’Entreprise. Dans la start-up Nation, l’État, les corps intermédiaires et les assemblées sont perçus comme des freins à l’efficacité – des obstacles à éliminer.
Une gouvernance résolument anti-politique s’installe.
L’Empire du Management
La corpocratie apparaît comme l’aboutissement du post-capitalisme contemporain, une mutation profonde et fascinante, rendue possible – voire inévitable – dans une société éclatée, celle des individus atomisés, qui a pris forme il y a une cinquantaine d’années avec l’effondrement du cadre religieux.
Cet effondrement lui-même s’inscrit dans le prolongement de l’évolution politique occidentale, que Pierre Musso résume en trois décapitations successives : celles de Dieu, du Roi et du Peuple.
Il en résulte une dissolution du symbolisme, un renoncement à l’incarnation d’origine théologique, et la disparition du grand mystère de la religion politique. La question du "pourquoi" a été supplantée par celle du "comment", entraînant un aplatissement du politique et l’avènement d’un homme unidimensionnel.
Le vide laissé par la mise entre parenthèses du questionnement métaphysique – relégué à la sphère privée – n’a pu être comblé que provisoirement par des artifices techniques. L'animal artificiel de Hobbes, ce monstre mécanique qu’est l’État, ainsi que l’illusion de la Nation, n’ont été que des substituts fragiles, voués à l’obsolescence programmée.
La substitution de la représentation à l’incarnation n’a pas produit les résultats escomptés. La société se fragmente, faute d’une finalité supérieure qui en assurerait la cohésion.
« Le "clou symbolique" est défaillant : la politique ne parvient plus à relier les fins et les moyens, le pourquoi et le comment, la foi et la loi », écrit Pierre Musso.
Dans la conclusion du « Temps de l’État-Entreprise » il résume ainsi la problématique fondamentale liée à l’avènement de l’État-Entreprise :
« Le rideau tombe. La forme vide de la raison a triomphé. Le technicisme s’est abattu. La surrationalité s’impose à l’Occident. L’homme est gouverné par une seule mesure. La fonction symbolique du politique est en cours de migration vers la Grande Entreprise, sans territoire et globalisée. De décapitation en décapitation – des dieux, de Dieu, du Roi, du Peuple et enfin de la représentation elle-même – il ne reste qu’une seule tête politique, télé-réelle : celle du chef, faiseur de miroirs présentés aux citoyens-téléspectateurs-consommateurs-électeurs.
Berlusconi, Trump et Macron théâtralisent le corps du chef, la représentation-miroir, le double corps du souverain-manager, l’État-Entreprise, l’anti-politique en politique, et finalement la contestation de la religion politique sécularisée par la religion industrielle désécularisée.
Depuis le milieu du siècle des Lumières, la phobie libérale de l’État ne cesse de s’amplifier, et l’industrialisation l’a poussée à son paroxysme dans la recherche d’une marginalisation, d’une extinction, voire d’une aboliton. La religion industrielle séculière domine à son tour la religion politique, qui s’était imposée entre le XVIᵉ et le XVIIIᵉ siècle contre l’Église. La grande entreprise, devenue Corporation et même surcorporation transnationale, diabolise et pousse sa concurrente, l’institution étatico-politique, vers la marginalité, en la soumettant au paradigme cybernétique et au dogme managérial au nom de la rationalité ultra-techniciste.
Si l’État est exclu, la Corporation peut-elle devenir le nouveau Tiers garant (le « pourquoi ? ») indispensable à la structure ternaire qui fait tenir toute société ? Crée-t-elle de nouvelles divinités technoscientifiques susceptibles de jouer le rôle symbolique de garant ?
Que deviendra la conscience humaine si son pouvoir explicatif est dépassé par l’IA et que les sociétés ne sont plus en mesure d’interpréter le monde dans lequel elles habitent ? »
Le bruit et la fureur
La géopolitique de la corpocratie s’oppose aux approches traditionnelles, fondées sur des valeurs ou des intérêts nationaux à long terme. Vraisemblablement, l’avenir de la politique étrangère américaine sera de plus en plus déterminé par les intérêts des multinationales – les véritables bénéficiaires des transformations en cours.
À l’international, la révolution trumpienne agit avant tout comme un catalyseur de la destruction de l’ancien monde. Elle accélère les processus de déstructuration et pousse chaque acteur à clarifier sa position, à définir son essence, à révéler ses intérêts vitaux et ce pour quoi il est prêt à se battre. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Union européenne se retrouve désemparée : dépourvue d’une identité propre (si ce n’est celle de tolérer toutes les identités), elle peine à formuler un intérêt commun, si ce n’est la volonté tacite de ne pas avoir à décider, de ne pas grandir, de rester dans le « monde d’avant ». Les déclarations grandiloquentes de ses dirigeants ne convainquent personne. Qui, en Europe, est prêt à sacrifier son pouvoir d’achat pour des « valeurs européennes » ? Quelles sont d’ailleurs ces « valeurs européennes », à part un attachement à un pouvoir d’achat relativement élevé, garanti pendant des décennies par le coût très modéré de la protection américaine, des ressources russes et des importations chinoises ?
Tout cela est fini, ou sur le point de l’être. Le réveil est brutal.
L’effondrement fracassant du système international et de ses institutions, qui se déroule sous le regard médusé des alliés américains et mi-amusé des autres, qui ne vivent pas aux crochets de Washington et de USAid, est le prolongement de la même approche brutale, entrepreneuriale et transactionnelle – « You are fired ». « I won’t pay for you ». « What do I get in return ? » « Deal with it yourself ! » Le vrai visage de la domination, dissimulé sous les apparences du rules-based order, transparaît clairement.
Si la révolution « trumpienne » s’avère être, avant tout, la deuxième révolution bourgeoise et l’accélération d’une marche libertarienne vers une corpocratie dirigée par des divinités techno-scientifiques, alors ceux qui cherchent une autre voie – différente à la fois du projet libéral-globaliste-wokiste et de la corpocratie des millionnaires transhumanistes – doivent sortir du bois.
Et si le véritable enjeu n’était pas de rivaliser avec les États-Unis en développant des technologies comparables, ni de les imiter en tant que champions du bon sens et du réalisme politique, mais d’offrir un projet politique fondamentalement différent ?
Verra-t-on émerger une alternative qui serait réellement celle dont rêvent de nombreux citoyens attachés à leurs héritages locaux ? Une alternative fondée sur un conservatisme ontologique, tel qu’il a été défini par Gunter Anders, Albert Camus ou Nikolaï Berdiaev : non pas un mouvement visant à refaire le monde, mais à empêcher que le monde et l’humain ne se défassent complètement.
Qui seront les acteurs en mesure de déclarer résolument « I’ll take my stand » ?
La véritable révolution ne serait alors ni une révolution bourgeoise, ni un simple retour au bon sens, mais une quête d’autres Lumières que celles brandies par la statue de la Liberté. Trop longtemps, nous avons cru que ces flammes étaient les seules capables d’éclairer et de réchauffer l’humanité.
.jpg)
.jpg)

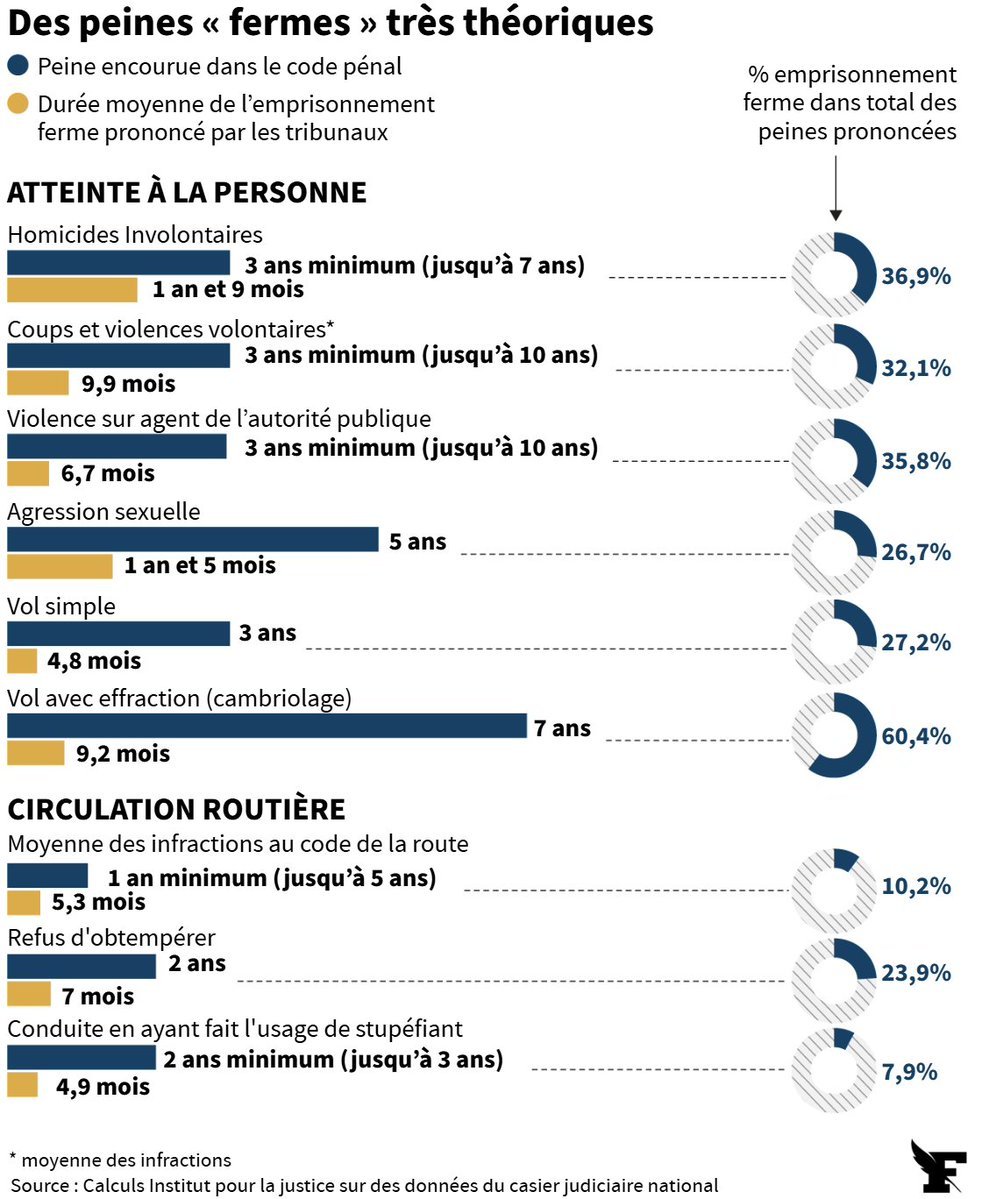



.jpg)